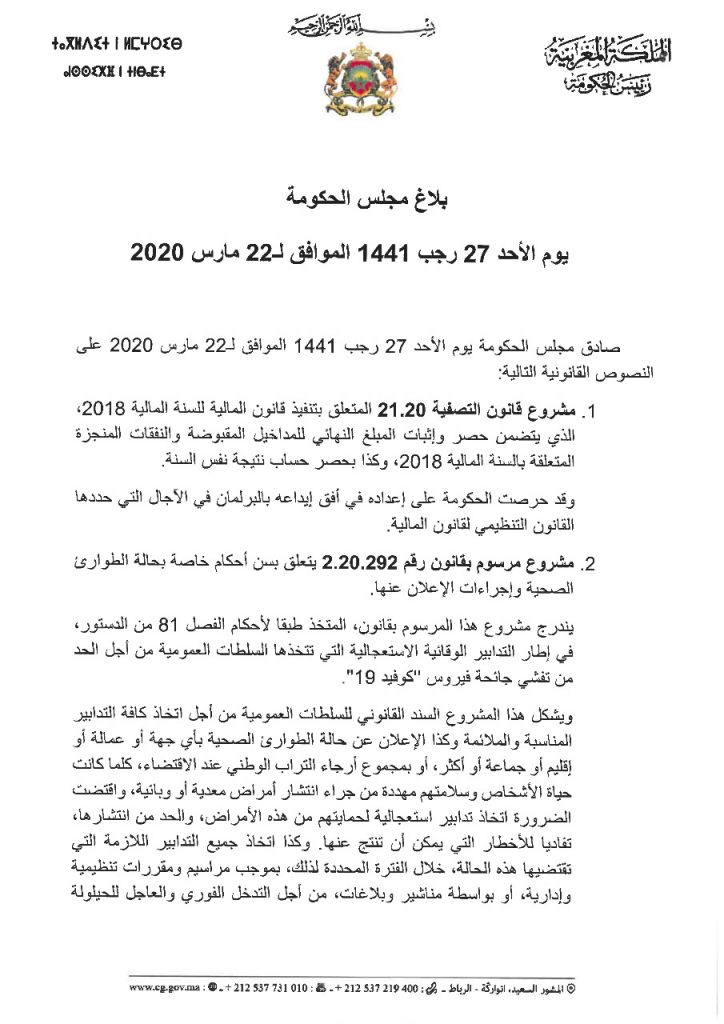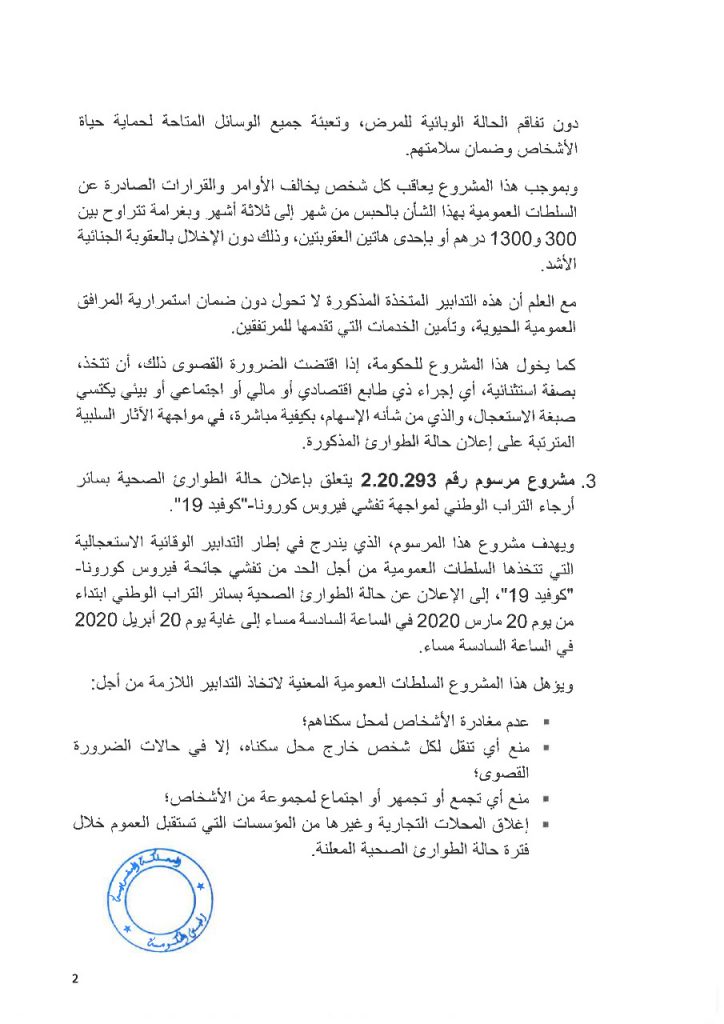La réaction de la majorité des Etats du monde s’est inscrite dans des mesures de précaution et restriction pour protéger leurs populations de ce mal universel.
Le Maroc a procédé dès le début de l’apparition de cette maladie en Chine à l’instauration des mesures sanitaires pour préserver les citoyennes et les citoyens marocains. Lesdites mesures ont évolué progressivement depuis l’apparition d’une manière importante des cas en Europe et puis surtout depuis l’apparition du premier cas au Maroc.
Dans ce sens, la prise de décision par l’Etat marocain s’est décliné dans le respect des principes et de l’esprit de sa loi fondamentale et de tous les textes juridiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels adhère le Maroc de part sa Constitution, qui stipule expressément dans son préambule que : « le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.» . Ou encore au vu du TITRE II de sa loi suprême, intitulé « Libertés et droits fondamentaux », ou encore selon les autres articles de la Constitution consacrés à la protection de ces droits et libertés.
Dans tous les Etats du monde, face à des circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles sont adoptées, et deviennent, plus que jamais, indispensables pour assurer la survie du pays, de ses habitants, de ses institutions et de sa démocratie. En effet, les droits de l’homme et les libertés fondamentales peuvent subir des limitations ou des restrictions lorsqu’on se trouve dans des situations exceptionnelles. Par ailleurs, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, stipule dans l’alinéa premier de son article 4 d’une manière claire que : « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ».
Face à cette situation exceptionnelle, l’expression juridique concernant les libertés publiques et des droits de l’homme en période exceptionnelle avec la répartition des compétences entre la loi et le règlement en cette période, et au vu du compromis qui doit être réalisé entre la préservation des libertés publiques et le maintien de l’ordre public, trois régimes exceptionnels sont prévus dans la majorité des pays du monde, à savoir:
- Le Régime législatif, (L’état de siège)
- Le Régime jurisprudentiel (La théorie des circonstances exceptionnelles)
- Le Régime Constitutionnel.
Pour le régime législatif, c’est-à-dire l’état de siège, c’est un régime exceptionnel de police. Il peut être déclaré dans tout le pays ou dans une partie seulement. Au Maroc, en vertu des articles 49 et 74 de sa Constitution, « l’état de siège est déclaré après délibération en Conseil de ministres », qui est présidé par le Roi, et « par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de 30 jours » et que ce délai « ne peut être prorogé que par la loi. ».
Pour ce qui est du Régime jurisprudentiel dit aussi : La théorie des circonstances exceptionnelles, il faut savoir que c’est une construction juridique d’origine jurisprudentielle, selon laquelle certaines décisions qui seraient illégales en temps normal peuvent devenir légales en certaines circonstances (guerre, pandémie, crise générale, menace grave de désordre), car elles deviennent nécessaires pour permettre le maintien de l’ordre public et la marche des services publics. Le juge administratif, quant à lui, est saisi à posteriori pour statuer sur la légalité de l’acte qui lui est soumis.
Dans cette perspective, les circonstances exceptionnelles sont susceptibles de justifier, en fonction du temps et du lieu, une extension des pouvoirs de police et par conséquence une limitation des libertés publiques. Des circonstances comme la guerre, une catastrophe naturelle ou encore le cas d’une épidémie comme celle du Covid 19 que nous vivons aujourd’hui.
Cette théorie des circonstances exceptionnelles peut s’appliquer aux différentes situations d’état de siège, d’état d’urgence ou d’état d’exception.
En ce sens, pour ce qui est de l’état d’urgence, dont les motifs de déclaration sont, un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique, peut faire face à une situation spécifique et réduit l’exercice des libertés.
Le Maroc, devant le péril de la pandémie du Coronavirus se trouve dans l’obligation de recourir à cet état d’urgence notamment d’ordre sanitaire, pour établir les instruments juridiques nécessaires, afin d’endiguer cette pathologie et agir face aux comportements irresponsables de certaines personnes qui ne respectent pas les mesures de précaution instaurées par l’Etat.
A ce propos, le Gouvernement a adopté aujourd’hui le 22 mars 2020 le projet de Décret de loi 2.20.292. , relatif à l’établissement des mesures spéciales à l’état d’urgence sanitaire, et ce en parfaite application du texte constitutionnel, dans son article 81 qui permet au gouvernement de prendre « dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants. ». Un deuxième décret, 2.20.293 qui déclare l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national du 20 mars au 20 avril 2020.
Ce projet de loi est l’outil juridique qui va permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires, ainsi que la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans n’importe quelle Région, ou préfecture, ou province, ou commune ou plus, ou dans tout le territoire national.
Aussi, il est important de rappeler que le Décret royal n° 554-65 du 17 rabiaa I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies, était surtout relatif à la déclaration obligatoire et immédiate simultanément à l’autorité administrative locale et à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale par les membres des professions médicales qui ont constaté l’existence, « des cas de maladies quarantenaires, de maladies à caractère social, de maladies contagieuses ou épidémiques ». Ou encore, en cas de leur suspicion de l’existence d’un cas desdites maladies, d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale, laquelle doit faire confirmer ce cas de maladie par un médecin.
Cette loi précise aussi que les formes, les conditions et les délais dans lesquels doivent être faites ces déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique. Et que L’autorité médicale préfectorale ou provinciale doit faire procéder à la désinfection ou à la désinsectisation des locaux habités et du mobilier utilisé par toute personne atteinte de certaines de ces maladies. Et qu’en cas de danger grave pour la santé publique, nécessitant des mesures d’urgence, le médecin chef de la province ou de la préfecture, auquel est laissé le soin d’apprécier le degré de gravité et d’urgence du cas, est habilité à ordonner d’office l’hospitalisation de toute personne atteinte d’une de ces pathologies ou de toute personne susceptible de les propager. Les sanctions prévues concernaient essentiellement la non application des dispositions de ce Décret royal par les personnes concernées, c’est-à-dire les membres des professions médicales et non la population.
Pour ce qui est du Régime constitutionnel ou l’état d’exception, l’article 59 de la Constitution marocaine de 2011, marque une nette évolution par rapport à l’article 35 de la Constitution de 1996 et précédentes. En effet, l’article 59 démontre d’une consolidation de la démocratie d’une manière explicite, puisque ledit article stipule expressément que : « Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l’état d’exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans le moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis. Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus. »
Après avoir étudier d’une manière détaillée la répartition des compétences entre la loi et le règlement dans les périodes exceptionnelles, et les différents régimes auxquelles recourent tous les Etats du monde, dont le Maroc pour maintenir le compromis qui doit être conçu entre la préservation des libertés publiques et le maintien de l’ordre public et la sécurité publique ; nous ne pouvons que saluer toutes les mesures de précaution prise par l’Etat marocain depuis le début pour combattre cette épidémie et demander à la population se conformer à toutes mesures imposées par l’Etat, pour pouvoir sortir, nous l’espérons avec le moins de dégât humain possible…