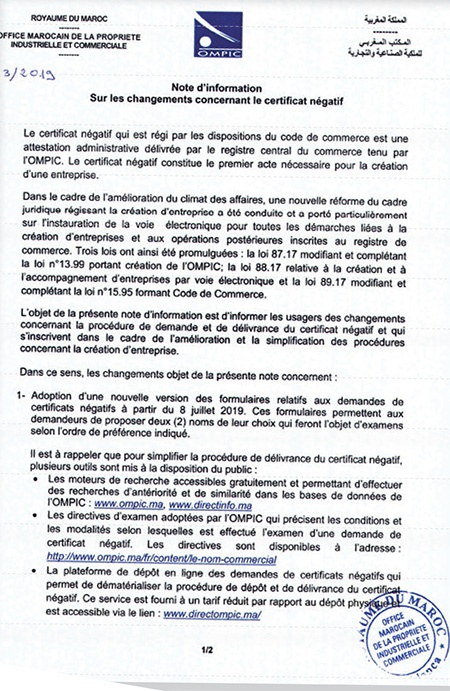Réformes de la classification des créances : Bank Al-Maghrib maintient la pression
La Banque centrale a poursuivi en 2018 ses travaux de convergence du cadre réglementaire bancaire marocain avec les standards internationaux et de parachèvement de la réglementation applicable aux nouveaux acteurs du paysage bancaire. En effet, dix nouvelles circulaires ont été édictées portant, entre autres, sur le cadre prudentiel des banques participatives et des organismes assimilés, la garantie des dépôts, ou encore les règles régissant le comité d’audit et le comité des risques.
Elle a également (surtout) poursuivi les travaux relatifs à la réforme des règles de classification des créances, et engagé en parallèle des consultations avec la profession bancaire sur la mise en place d’un cadre régissant les opérations de dations en paiement et ventes à réméré.
Il faut dire que le recours par les banques aux techniques des dations en paiement et ventes à réméré s’est accru au cours des dernières années. Pour rappel, le premier mécanisme consiste à transférer un bien à la banque en contrepartie de l’extinction d’une partie ou la totalité d’une créance en souffrance, alors que la vente à réméré donne lieu à un transfert de bien de manière momentanée pour une période de 3 ans au plus. Durant cette période, le débiteur peut racheter le bien.
Le recours croissant à ces mécanismes, notamment en termes d’actifs immobiliers, a provoqué un risque de liquidité pour les banques et a dénaturé leur activité.
Pour prémunir les banques du risque immobilier qu’elles encourent en détenant ces actifs dans leur bilan, Bank Al-Maghrib a depuis quelques temps entrepris un vaste chantier visant à encadrer la pratique et tenter d’en atténuer les risques.
Dans ce cadre, une étude quantitative sur ces actifs a été conduite auprès des banques, au cours du 2ème semestre 2018. Un premier projet de texte réglementaire a été élaboré et a fait l’objet d’une première consultation auprès des acteurs bancaires. Sur la base des conclusions de la consultation, BAM a engagé des travaux d’ajustement du cadre proposé, tout en menant une étude d’impact des règles retenues.
Réformes de la classification des créances : Adoption prévue pour le troisième trimestre 2019
«Le scénario du traitement prudentiel est presque stabilisé», a fait savoir Hiba Zahoui, directrice de la Supervision bancaire auprès de Bank Al-Maghrib, ce lundi en conférence de presse. La responsable a par ailleurs apporté une précision de taille : «Si dans les 4 ans suivant la détention de l’actif, la banque ne procède pas à sa cession, elle devra constituer, en face, des fonds propres à hauteur de 30% de la valeur de l’actif en question».
L’autre précision apportée concerne la gestion de ces actifs acquis par voie de dations. H. Zahoui explique que la directive définit les éléments à prendre en considération au niveau de la valorisation en entrée, et aussi les exigences en matière d’expertise (nombre de fois, choix de l’expertise, mise à jour etc.), et ce en fonction du montant de l’actif.
D’après la directrice de la Supervision bancaire, le texte est en phase avancée de consultation avec les banques (2ème consultation). L’adoption est prévue pour le troisième trimestre 2019.
Réformes de la classification des créances : Le stock d’actifs immobiliers s’élève à 18 Mds de DH
La réforme s’appliquera en particulier aux anciens stocks d’actifs immobiliers acquis en dations de paiement par les banques, notamment auprès de promoteurs en difficulté. Le stock varie aujourd’hui aux alentours de 18 milliards de DH, ce qui représente 1,5% du total des actifs des banques.
Cette réforme, tout comme celle de l’IFRS9, se fera de manière progressive via des dispositions transitoires, assure-t-on du côté de la Banque centrale.
«Nous aurons un lissage sur 5 ans, sauf pour les nouveaux flux (les nouveaux biens immobiliers acquis (ndlr)», précise H. Zahoui.
Circulaire 19-G : Première application en 2022
L’autre chantier de taille, gourmand en fonds propres, mené par la Banque centrale, concerne la réforme de la classification des créances. Les consultations avec la profession bancaire se sont poursuivies et une mise à jour de l’étude d’impact a été effectuée.
Ce chantier a toutefois été différé après l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9, comme nous vous l’indiquions déjà sur ces colonnes, pour éviter les contraintes induites aux plans financier, technique et des ressources, par le lancement simultané de deux réformes aussi importantes.
«On a voulu éviter des effets réglementaires superposés qui induisent des contraintes importantes sur l’octroi de crédit», justifie-t-on du côté de la DSB.
Ainsi, au terme des consultations avec la profession, deux dates d’entrée en vigueur ont été retenues : fin 2022, d’une part, pour les dispositions régissant les créances en souffrance; fin 2024, d’autre part, pour les dispositions régissant les créances sensibles.
La DSB nous apprend que «les banques ont été appelées à mener des actions préparatoires à l’entrée en vigueur de la réforme, en particulier la mise en place de plans d’assainissement des dépassements persistants par rapport aux lignes autorisées. Ces actions d’assainissement visent à baisser le niveau des dépassements dégagé lors des études d’impact pour limiter l’impact réel lors de l’entrée en vigueur de la réforme».
Parallèlement, les travaux ont également porté sur le traitement comptable de l’impact de la première application, selon les normes comptables marocaines en vigueur pour l’établissement des comptes sociaux. Ces travaux vont se poursuivre en 2019 avec les banques et les commissaires aux comptes et donneront lieu à une consultation du Conseil national de la comptabilité.
Réformes de la classification des créances : Quels apports de la réforme ?
Deux objectifs sont visés par cette réforme, à en croire la DSB : renforcer la solidité des banques et promouvoir des règles saines en matière de gestion du risque de crédit, en convergence avec les normes internationales.
Avec cette réforme, la notion de défaut sera ainsi élargie en intégrant de nouveaux critères, notamment les dépassements persistants au-delà de 90 jours sur les lignes autorisées.
Une classe intermédiaire de risque dite «créances sensibles» sera également introduite, avec une définition des critères qualitatifs et quantitatifs minimums de classification des créances parmi cette classe de risque, ainsi que les modalités de constitution des provisions y afférentes.
La circulaire 19-G prévoit enfin une revue des dispositions liées aux créances restructurées, portant notamment sur la définition des restructurations, la période d’observation et le traitement comptable.
Par : Y.S